Composition du Gouvernement
Annoncé 11/01/2024|Mis à jour 09/02/2024
Premier ministre
Gabriel Attal
Premier ministre

Prisca Thevenot
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement

Marie Lebec
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement

Aurore Bergé
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les Discriminations

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Bruno Le Maire
Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Roland Lescure
Ministre délégué auprés du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'Industrie et de l'Énergie

Olivia Grégoire
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation

Thomas Cazenave
Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics

Marina Ferrari
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique

Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer
Gérald Darmanin
Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

Dominique Faure
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité
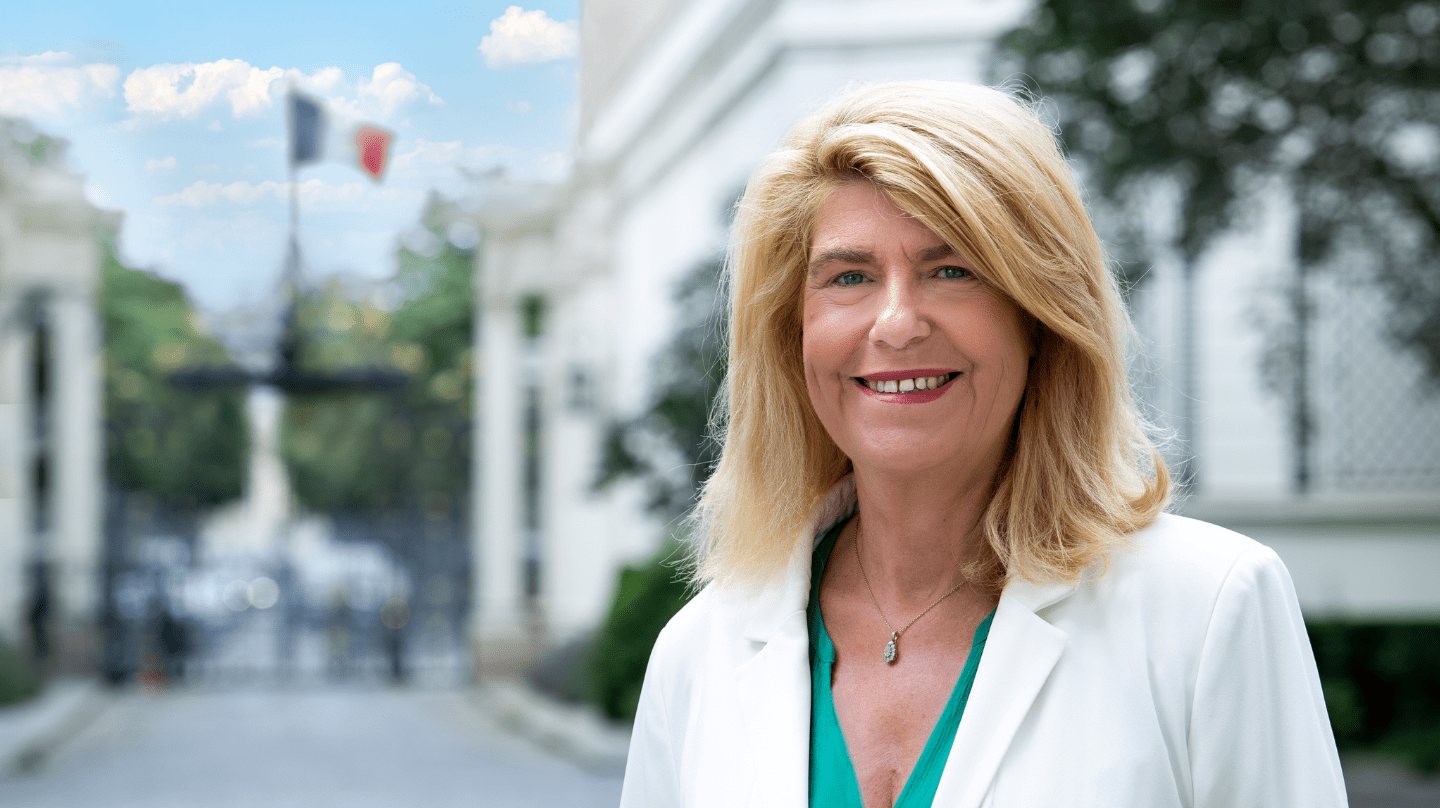
Marie Guévenoux
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, chargée des Outre-mer

Sabrina Agresti-Roubache
Secrétaire d'État auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, chargée de la Citoyenneté

Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités
Catherine Vautrin
Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

Fadila Khattabi
Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées

Frédéric Valletoux
Ministre délégué auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, chargé de la Santé et de la Prévention

Sarah El Haïry
Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles

Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Nicole Belloubet
Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Sarah El Haïry
Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles

Ministère de la Culture
Rachida Dati
Ministre de la Culture

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Marc Fesneau
Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
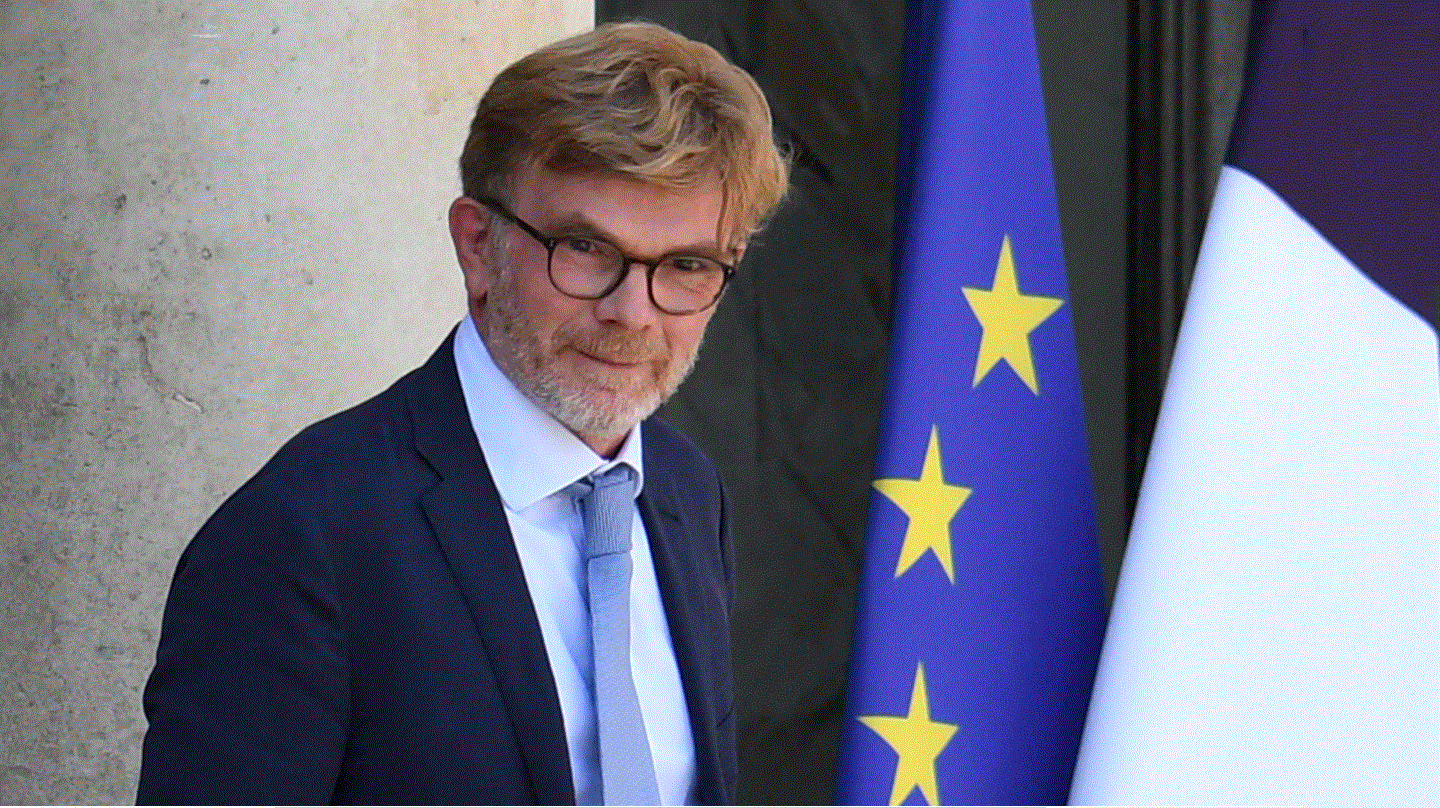
Agnès Pannier-Runacher
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Christophe Béchu
Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Dominique Faure
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité
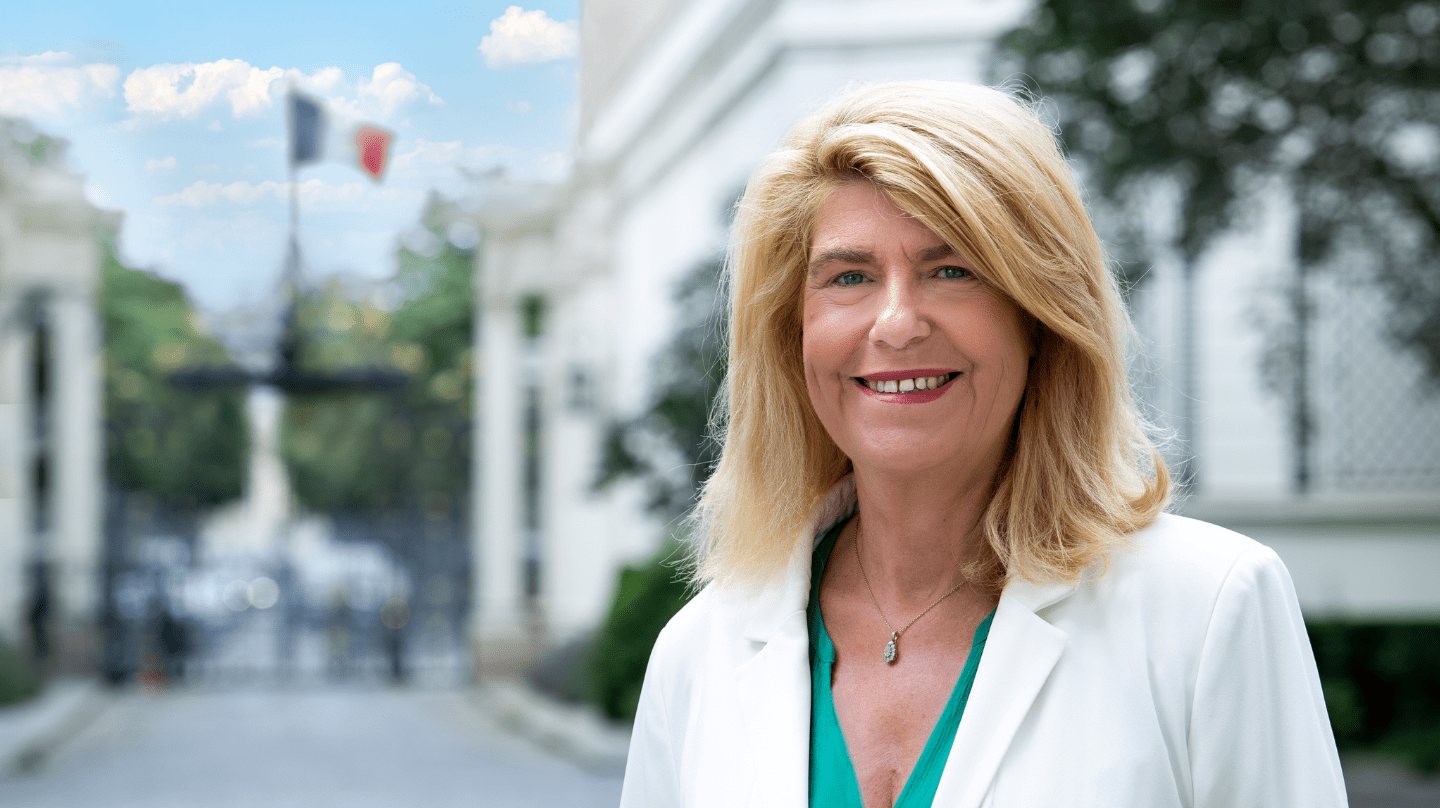
Patrice Vergriete
Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports

Guillaume Kasbarian
Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé du Logement

Sabrina Agresti-Roubache
Secrétaire d'État auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ville

Hervé Berville
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Mer et de la Biodiversité

Ministère des Armées
Sébastien Lecornu
Ministre des Armées

Patricia Mirallès
Secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire

Ministère de la Justice
Éric Dupond-Moretti
Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sarah El Haïry
Ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles

Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Stéphane Séjourné
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Franck Riester
Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité, de la Francophonie et des Français de l'étranger

Jean-Noël Barrot
Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe

Chrysoula Zacharopoulou
Secrétaire d'État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du Développement et des Partenariats internationaux

Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques
Stanislas Guerini
Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques
Amélie Oudéa-Castéra
Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Sylvie Retailleau
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
